Retour sur la Rencontre sur la transition écologique et les 10 ans de l’encyclique Laudato Si’
Entre science et spiritualité
Clim’actions Bretagne a organisé le 1er avril 2025 au Palais des arts de Vannes une rencontre pour mettre en dialogue la science et la spiritualité à l’occasion des 10 ans de l’encyclique du pape Laudato si’ et des 10 ans de l’accord de Paris.
L’évènement, organisé en partenariat avec le CCFD Terre-Solidaire, le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), l’Espace Montcalm de Vannes et avec le soutien du Cèdre, a réuni 160 participants.

Les intervenantes
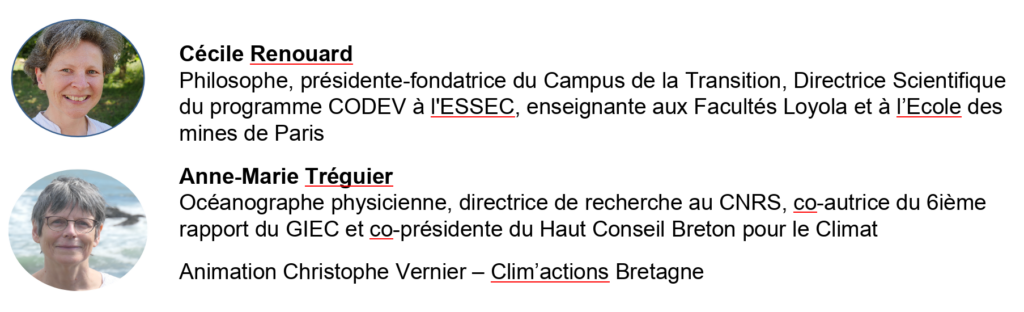
Synthèse
1. Anne-Marie Tréguier fait le point sur l’évolution du changement climatique.
La température globale de la planète a été en 2024 de 1,55° supérieure à la période pré-industrielle. Le réchauffement est plus marqué sur les continents que sur les océans, et plus rapide que prévu notamment en Europe de l’ouest. Les activités humaines sont responsables du réchauffement, avec des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui, après deux inflexions observées au moment de la crise financière de 2008 et au moment du Covid, sont reparties à la hausse tout en ralentissant. Nous avons en 5 ans « consommé » 50% du budget carbone qui permettrait de limiter l’augmentation de la température à 1,5° et les politiques actuelles conduisent à 3,2° en 2100 si elles ne sont pas revues. La Bretagne n’est pas épargnée, avec +1°c observé à Rennes depuis 1950, soit l’équivalent du climat à Bordeaux à la même époque, et un quasi-doublement du nombre de jours chauds sur la période. Un autre effet du réchauffement est l’acidification des océans, qui fragilise notamment les coquilles calcaires des mollusques et la croissance des algues avec des effets sur la chaîne alimentaire. Le niveau de la mer à Brest a augmenté de 15 cm depuis 1970 et pourrait atteindre 50 à 80 cm à la fin du siècle. Les impacts sur l’agriculture sont déjà constatés en Bretagne, avec le maïs menacé par les sécheresses, le gel tardif des pommiers mais aussi des opportunités de nouvelles cultures comme le thé, la vigne, ou le sorgo. Au plan mondial, il est clairement établi que les communautés ayant le moins contribué au réchauffement climatique sont les plus vulnérables à ses impacts, sur qui pose la question de la justice climatique.

2. Intervention Cécile Renouard
Le projet du Campus de la Transition fondé en 2018 est de « former pour transformer » l’enseignement supérieur et les responsables d’aujourd’hui et de demain en vue d’une transition écologique et solidaire. Des formations, recherche-actions et expérimentations y sont menées, avec un collectif d’une trentaine de résidents qui s’efforcent de mettre en œuvre la transition dans leur quotidien.
Les 10 dernières années sont marquées par un contexte de plus en plus incertain : dépassement des frontières écologiques planétaires, revendications du sud global, fin du rêve de la mondialisation heureuse, tensions géopolitiques et démocratiques, polarisation des opinions, montées des post-vérités, nombreuses questions sociétales sur le rapport à soi, aux autres et à la nature, émergence de l’IA… tout cela conduit à un « éboulement de nos certitudes ».
La structure de l’encyclique Laudato si’ adressée à « toutes les personnes de bonne volonté » alterne des chapitres non confessants et des chapitres faisant référence aux sources et traditions chrétiennes :
- Chp 1: « Ce qui se passe dans notre maison », qui pose le diagnostic, la gravité et l’urgence de la situation.
- Chp 2: « l’Evangile de la Création », invitant à une ontologie relationnelle entre les Hommes et le cosmos.
- Ch 3: « La racine humaine de la crise écologique », qui pointe notamment l’anthropocentrisme déviant qui privilégie le seul bien-être humain aux dépens des écosystèmes.
- Chapitre 4: « Une écologie intégrale », à la fois environnementale, sociale, écologique, culturelle et citoyenne, orientée par le souci de la justice et des biens communs, et impliquant nos choix quotidiens, collectifs, structurels et institutionnels.
- Chapitre 5: « Quelques lignes d’orientation et d’action », appelant au dialogue entre la science et le spirituel, entre les mondes économiques et politiques, en accordant une place indispensable aux citoyens.
- Chapitre 6: « Education et spiritualité écologiques », avec la proposition de deux prières, l’une avec les mots chrétiens, et l’autre pensée comme une méditation universelle pour tous les humains.
Des appels de Laudato si’ plus que jamais d’actualité
Promouvoir une éducation pour une conversion écologique et sociale à la fois dans les formations initiales et les formations permanentes, favoriser l’accès de tous à la science pour mieux vivre ensemble, et expérimenter une sobriété positive.
Aller à la racine des problèmes. « Tout est lié » : les façons dont nous traitons les écosystèmes et la dignité humaine sont liées, ce qui renvoie au concept de santé unique.
Ecouter « le cri de la Terre et le cri des pauvres » : difficile à mettre en œuvre et nécessite un croisement des savoirs comme l’expérimente ATD Quart Monde. Personne n’a la solution tout seul et le Campus de la Transition vit cette dualité en s’efforçant de mettre en dialogue des étudiants militants avec les jeunes de la Mission locale ou des agriculteurs, sur un territoire votant à 50% pour le RN.
Promouvoir par l’écologie intégrale la transformation de l’économie dans le respect des cultures et renforcer le rôle des citoyens face aux collusions entre élites économiques et politiques. On ne peut s’accommoder des violences présentées comme des dommages collatéraux inévitables d’une économie néolibérale qui homogénéise les cultures.
Promouvoir l’action sociale et politique pour le climat et l’écologie à toutes les échelles, en particulier au niveau mondial, en prenant en compte la dette écologique de certains pays vis-à-vis d’autres, pour une meilleure justice climatique.
3. L’actualité et le risque de renoncement
Le contexte géopolitique, les nouvelles forces économiques et les pressions anti-normes désinhibées par les annonces de Donald Trump menacent aujourd’hui de nombreux engagements écologiques : reculs sur le ZAN, loi d’orientation agricole sans mention de l’agro-écologie, menaces sur l’OFB, l’Ademe, l’Agence Bio, remises en cause du Pacte Vert européen…Comment encourager les entreprises à poursuivre leurs engagements dans ce contexte ?
Pour Cécile Renouard, la priorité d’une « responsabilité systémique des entreprises » est dans la façon de partager la valeur créée, qui doit être durable, équitable et contribuer au soin des biens communs mondiaux. Le détricotage actuel de la réglementation sur le devoir de vigilance des grandes entreprises et les obligations de reporting extra-financier est catastrophique, au moment où nombre de dirigeants de grands groupes reconnaissent eux-mêmes le besoin d’aller vers une économie du « donut » respectant les plafonds environnementaux et les planchers sociaux. L’idée d’une décroissance des volumes de production et de la consommation, cantonnée il y a 20 ans au courant altermondialiste, commence même à être endossée par certains dirigeants. Le rôle des citoyens est essentiel pour inciter les entreprises à une redirection de leur modèle d’affaire, y compris vis-à-vis des plus petites entreprises.
4. L’adaptation au changement climatique
Le gouvernement vient d’adopter le 3ième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique en anticipant un scenario de + 2,7° en 2050 et +4° en 2100. Pourquoi un tel écart avec les objectifs de l’accord de Paris ? Est-il déjà trop tard ?
Pour Anne-Marie Tréguier, il est sans doute trop tard pour certaines dégradations comme celle de la grande barrière de corail, mais il n’est jamais trop tard pour agir et ralentir les effets du changement climatique. Chaque tonne de CO2 qui ne sera pas émise permettra quelques fractions de degré en moins. Le récent rapport de Météo France et le PNACC qui évoquent une perspective de 4° doivent être compris comme l’application du principe de précaution avec des hypothèses pessimistes mais pas comme un abandon de l’objectif de l’accord de Paris visant à la neutralité carbone pour ne pas dépasser 2°. Le Haut Conseil Breton pour le Climat a formulé un avis concerté avec les autres régions lors de la préparation du PNACC, en pointant par exemple le risque de renoncement sur le Zéro Artificialisation Nette et en regrettant que les mesures avancées manquent de hiérarchisation, de planification dans le temps et de visibilité sur leur financement. L’adaptation consiste également à faire des choix sur ce à quoi nous devons renoncer et ce qu’il faut au contraire protéger. A titre d’exemple, la thèse d’Eugénie Cazaux « Envie de rivage » pose la question de savoir jusqu’où l’indemnisation de maisons de vacance de bord de mer menacées par la montée des eaux doit bénéficier d’une solidarité de la part de territoires non concernés ou qui ont évité ces situations.

5. Sobriété
Laudato si’ évoque l’illusion de la disponibilité infinie des biens et l’illusion d’une liberté humaine reposant sur la consommation. Comment cela interroge notre rapport à la propriété, la culture de la consommation ? Comment apprécier et se contenter de ce que l’on ? qu’est-ce que cela implique au niveau individuel, collectif, politique ?
Cécile Renouard se réfère au terme anglais « sufficiency » de la sobriété. La sobriété ne doit pas priver de conditions de vie dignes ceux qui ont peu et concerne avant tout ceux qui ont beaucoup, voire trop. Elle nécessite aussi une prise de conscience de ce qui est insoutenable, par exemple : sur 130 milliards de vêtements fabriqués chaque année dans le monde, 30 milliards vont directement à la décharge ; la fabrication d’un jean nécessite 7 à 10 000 litres d’ d’eau, certains chemisiers vendus 29 € dans une grande surface ont rapporté 0,18€ à la couturière du Bengladesh… De la même façon que les COP appellent à une « responsabilité commune et différenciée » de tous les niveaux de gouvernance, du global au local, il s’agit aussi d’établir des normes de conditions de travail respectueuses des personnes et de l’environnement. Cela passe aussi par une éducation des consommateurs pour prendre conscience de leur coresponsabilité dans les chaines de valeurs. Laudato si’ appelle à une sobriété vécue avec liberté et de manière consciente, qui peut être libératrice en détournant nos frustrations matérielles vers les plaisir de la rencontre, de l’art, du contact avec la nature.
Anne-Marie Tréguier précise le rôle de la sobriété dans l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris. La sobriété est un ensemble de pratiques quotidiennes mais également une sobriété du système comme le souligne la définition du GIEC : « Un ensemble de politiques publiques de long terme qui évitent en amont la demande de matériaux, d’énergie, de terres, d’eau et d’autres ressources naturelles tout en livrant un niveau de vie décent pour tous dans le cadre des limites planétaires». Les travaux du GIEC estiment que 40% à 70% des émissions de GES pourraient être évitées en combinant les pratiques quotidiennes et des mesures de régulation de la demande de amont, en particulier sur l’alimentation, les transports terrestres et l’usage des bâtiments.
6. Science et éducation
Laudato Si’ parle d’« éducation pour une alliance entre l’humanité et l’environnement ». Le climatosceptisisme progresse en France, notamment chez les jeunes, et les scientifiques semblent de moins en moins écoutés. Le mouvement Stand Up for science du mois dernier réaffirme certaines valeurs fondamentales de la science, à commencer par « un attachement philosophique et politique à la vérité”.
Cécile Renouard témoigne de l’expérience du Campus de la Transition, à qui le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche avait demandé de travailler sur un socle commun de connaissances et de compétences nécessaires pour accompagner la transition. Le Campus a ainsi réuni 70 enseignants et chercheurs dans une approche interdisciplinaire pour produire le « Manuel de la Grande Transition », qui propose un socle de connaissances et de compétences sur les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et politiques de notre époque (Edition poche Les liens qui libèrent). L’ouvrage propose 6 portes que chacun peut ouvrir selon sa sensibilité. Oikos : habiter un monde commun ; Ethos : discerner et décider pour bien vivre ensemble ; Nomos : mesurer, réguler et gouverner ; Logos : interpréter, critiquer et imaginer ; Praxis : agir à la hauteur des enjeux ; Dynamis : se reconnecter à soi, aux autres et à la nature.
Anne-Marie Tréguier évoque la forte mobilisation de chercheurs en 2019 pour contester l’audition par le Conseil supérieur des programmes de l’éducation nationale d’un climatosceptique, et pour regretter le manque d’interdisciplinarité. Le Haut Conseil Breton pour le Climat s’implique particulièrement dans les travaux de l’Office for Climate Education qui vise à évaluer la formation continue des enseignants dans ce domaine (l’académie de Rennes est pilote) et organise le 15 mai à St Brieuc le 3ième forum « Climat et territoires » qui sera consacré à l’agriculture face au changement climatique.
Échanges avec la salle
Question : Le Campus de la transition travaille-t-il avec des économistes pour décrire le futur monde économique souhaitable et éclairer les politiques, notamment dans la perceptive des différentes élections ?
Réponse : sur l’économie, le Campus a une approche à la foi méso sur les entreprises et les filières, et macro sur les conceptions économiques. Il s’est entouré notamment des compétences de la plateforme « The other economy » animée par Alain Grandjean du cabinet Carbone 4, et travaille avec des professeurs d’économie, de finance et de gestion ainsi que des praticiens de terrain pour comprendre les freins et leviers au changement.
Question : pourquoi le scenario du pire est-il écarté dans les présentations, et les projections tiennent-elles compte des développements de l’intelligence artificielle qui ne poussent pas à la sobriété ?
Réponse : les courbes présentées sont issues des travaux du GIEC de 2021 avec l’hypothèse d’un niveau d’accumulation des GES dans l’atmosphère qui tend heureusement à ralentir. 18 pays signataires ont vu leurs émissions diminuer de manière continue depuis 10 ans, ce qui conforte l’utilité des COP. On atteint ainsi un plateau mais si la concentration de GES se stabilise, le réchauffement induit n’est pas établi avec certitude et les scientifiques travaillent sur différents modèles avec des scenarii hauts mais réalistes, en écartant le pire.
